
4 mai 2020
Search
Relations de travail
7 mai 2020
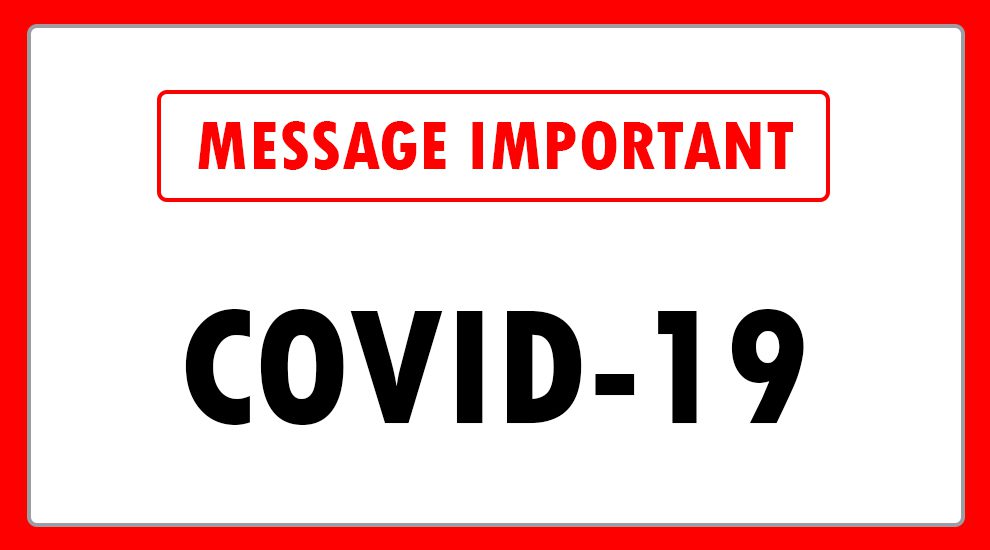
Les travailleurs qui quittent leur emploi volontairement n’ont pas droit à la PCU. Selon les dernières informations de l’Agence de revenu du Canada (ARC), si l’employeur fait un rappel au travail et que le travailleur ne veut pas revenir au travail, cela peut être interprété comme un départ volontaire et il ne serait plus admissible à la PCU.
Si le travailleur rappelé au travail durant la période où il touche la PCU, il doit faire un maximum de 1000 $ (avant impôt) durant la période en question pour conserver sa prestation.
S’il retourne au travail ou qu’il a un autre travail et qu’il fait plus de 1000 $ (avant impôt) lors de cette période-là, il devra rembourser la PCU à l’Agence du revenu du Canada.
Nous savons que le risque de complications graves pour les personnes atteintes de la COVID‑19 augmente avec l’âge, même s’il est aussi présent chez les jeunes adultes. Le risque de décès à la suite de complications graves dues à la COVID‑19 est particulièrement élevé chez les plus âgés. Nous avons tous entendu, dans les médias, toutes sortes de statistiques de complications pour les 60 ans et plus.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
L’ASPC a défini que le risque de conséquences graves de la COVID-19 était accru pour les personnes âgées de 65 ans et plus, celles ayant un système immunitaire affaibli et celles atteintes de problèmes de santé sous-jacents (p. ex. : maladie cardiaque, hypertension, diabète, maladies respiratoires chroniques, cancer). L’ASPC recommande de permettre aux employés vulnérables de réduire les contacts sociaux au travail, si possible, grâce au télétravail.
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Au Québec, l’INESSS a récemment souligné que les personnes âgées de 65 ans ou plus, celles présentant une maladie du système respiratoire, une maladie cardiovasculaire ou de l’hypertension pouvaient être plus à risque de complications (hospitalisation, admission aux soins intensifs et décès) lors d’une COVID-19.
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Les individus plus à risque de développer une maladie sévère suite à une infection au SARS-CoV-2 sont les immunodéprimés, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles âgées de plus de 70 ans.
À ce jour, en résumé, pour l’INSPQ, la CNESST et le gouvernement du Québec, les personnes considérées à risque ou vulnérables sont :
les personnes âgées de 70 ans et plus;
les personnes ayant un système immunitaire affaibli (immunosupprimé);
les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que : le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les maladies rénales.
« Le confinement est l’une des mesures mises en place par le gouvernement qui permettra de réduire la propagation de la COVID‑19. Les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que celles ayant un système immunitaire affaibli ou souffrant de maladies chroniques sont invitées à rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important.
Il n’est pas interdit pour une personne de plus de 70 ans de continuer à travailler.
L’employeur doit toutefois prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur (art. 51 LSST). Comme cette personne fait partie des personnes identifiées à risque, il appartient à l’employeur d’évaluer si sa présence au travail est nécessaire. L’employeur qui est d’avis que la présence de cette personne est nécessaire doit s’assurer de mettre en place les consignes de la DSP dans le milieu de travail, notamment les mesures d’hygiène et de distanciation de 2 m.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail (art. 49 de la LSST). Si le travailleur a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger, il peut exercer un droit de refus tel que prévu à l’art. 12 LSST. »
Quel que soit le besoin de consultation, pour des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID‑19, composez le 418 644‑4545, 450 644‑4545, 514 644‑4545, 819 644‑4545 ou 1 877 644‑4545(sans frais) pour être dirigé vers la bonne ressource. En l’absence de tels symptômes et si la personne ressent le besoin de consulter, elle peut communiquer avec son médecin de famille, sa clinique médicale ou son groupe de médecine de famille (GMF), où un rendez-vous pour une consultation téléphonique ou en personne pourra être proposé. S’il est difficile de joindre sa clinique médicale, ou si la personne n’est pas inscrite auprès d’un médecin de famille, il est possible d’appeler Info-santé 811 pour parler à une infirmière et obtenir des conseils sur la conduite à prendre et être dirigé, au besoin, vers la ressource appropriée.
La démonstration que la COVID-19 a été contractée dans le milieu de travail doit être faite par prépondérance de preuve.
La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.

4 mai 2020
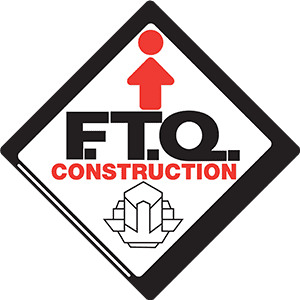
30 avril 2020

27 avril 2020