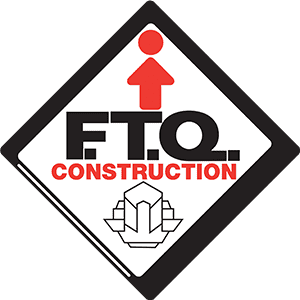Les syndicats ont été largement affaiblis partout depuis les années 1980, même si le code du travail a permis aux syndicats québécois le maintien de leur puissance institutionnelle. Une des causes de cet affaiblissement est bien connue : la mondialisation. Une autre, aussi importante, est souvent ignorée : l’individualisation de l’organisation du travail.
La mondialisation
Les multinationales ont le gros bout du bâton par rapport à beaucoup de syndicats. Ou bien les ouvriers acceptent de travailler plus intensivement et de réduire leurs attentes en avantages sociaux et en salaires ou bien elles déménagent la totalité ou une partie de la production dans les pays où les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés. Dans ces pays, et particulièrement en Chine, des luttes ouvrières se développent contre l’exploitation, mais sans que nous soyons actuellement capables de lier théoriquement et stratégiquement ces luttes à celles qui pourraient se déployer ici.
Au Québec et au Canada, on sait d’où ça vient : les traités de libre-échange, dont celui de l’ALENA défendu par Bernard Landry du PQ, Robert Bourassa (1933-1996) du PLQ et Brian Mulroney du PCC, ont soustrait les investissements au contrôle de l’État. Les nouveaux moyens de communication, dont le WEB, permettent aux grandes institutions financières de déplacer leurs avoirs d’un pays à un autre, comme si les frontières avaient été abolies. Les politiques néolibérales soutenues par l’hyperpuissance étatsunienne et par les institutions économiques internationales ont enlevé aux États nationaux, sans complètement le faire disparaître, le contrôle des principaux paramètres du développement économique et social.
L’individualisation
Le mouvement des travailleurs a également été affaibli de l’intérieur, comme l’explique bien Robert Castel dans La montée des incertitudes, par une politique délibérée des entrepreneurs et de leurs spécialistes en relations industrielles et en ressources humaines. D’une part, on a coupé en deux le collectif des travailleurs, en créant, à côté du travailleur à plein temps jouissant d’une certaine sécurité d’emploi, le travailleur précaire. D’autre part, parmi les travailleurs réguliers, on a stimulé la concurrence, fossoyeuse de solidarité. Voyons cela de plus près.
Aujourd’hui, 40 % de la main-d’œuvre des secteurs public et privé ne jouit plus d’un emploi régulier. Elle est ainsi soumise à l’incertitude du marché. Le travailleur précaire doit se débrouiller seul pour joindre les deux bouts face à un avenir qu’il ne maîtrise pas. À la stabilité de l’emploi dominant dans les années 1960, s’est donc substituée peu à peu l’instabilité comme régime d’organisation du travail. Le précariat affecte particulièrement les jeunes, les femmes et les immigrants, quoique tout travailleur permanent du secteur privé risque d’y choir. Cette situation d’incertitude engendre l’individualisme, car la vie d’un précaire ne relève en dernière instance que de lui-même, qu’il soit un battant ou un perdant. Cette individualisation est renforcée par l’éclatement de la famille traditionnelle où l’enfant, renvoyé à lui-même, doit construire sa propre identité, en négociant ses rapports avec son père, sa mère, son beau-père, sa belle-mère…
Même au sein des travailleurs permanents, le principe d’individualisation tend à restructurer l’organisation du travail. Les contremaîtres, représentant le patronat, ont été souvent remplacés par de petits groupes de travailleurs qui doivent se répartir les tâches avec les exigences de flexibilité externe et interne, de mobilité, d’adaptabilité et de polyvalence. Les travailleurs, unis jadis collectivement contre les patrons, se divisent entre eux, intégrant les directives patronales. Le développement du harcèlement au travail est une conséquence de la nouvelle organisation du travail : chaque travailleur au sein d’un groupe semi-autonome du travail est appelé à devenir un contremaître et à faire pression sur celui qui performe moins bien.
De plus, l’État, malgré l’augmentation de la production, n’aurait plus les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins sociaux. Depuis les années 1980, le niveau de vie de la population des pays industrialisés a stagné, tandis que celui des dirigeants d’entreprises a été multiplié de sorte que, pour une heure de travail, un dirigeant est maintenant payé 400 fois plus qu’un travailleur. L’État social ne peut plus être financé, car on a réduit considérablement l’impôt des entreprises, comprimé la progressivité de l’impôt des citoyens et laissé se développer les abris et les paradis fiscaux dont se délectent les riches. Les travailleurs, étant moins protégés par l’État, sont laissés à eux-mêmes : ils seraient responsables de leur vie dans une situation qui se détériore et qu’ils ne contrôlent pas.
Que faire?
Il faut défendre les acquis qui sont des droits sociaux conquis de hautes luttes. Il faut, de plus, créer le maximum de réseaux internationaux liant non seulement les forces syndicales, mais tous ceux au prise avec une mondialisation débridée. Placés sur la défensive, les syndicats ne peuvent s’en sortir seuls; ils doivent impérativement se repolitiser et situer leurs revendications dans une perspective rassembleuse. Enfin, les syndicats doivent développer une sensibilité aux individualités et des moyens pour rejoindre chaque personne, car il semble bien que dorénavant la solidarité ne peut être construite que sur l’adhésion consciente d’individus qui se constituent en citoyens.
JEAN-MARC PIOTTE
Collaboration spéciale avec la revue À Bâbord!